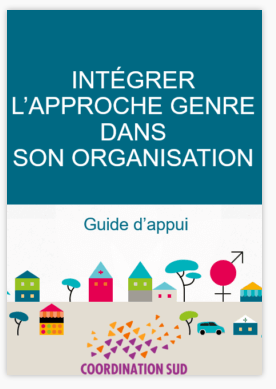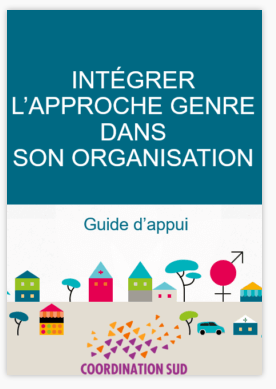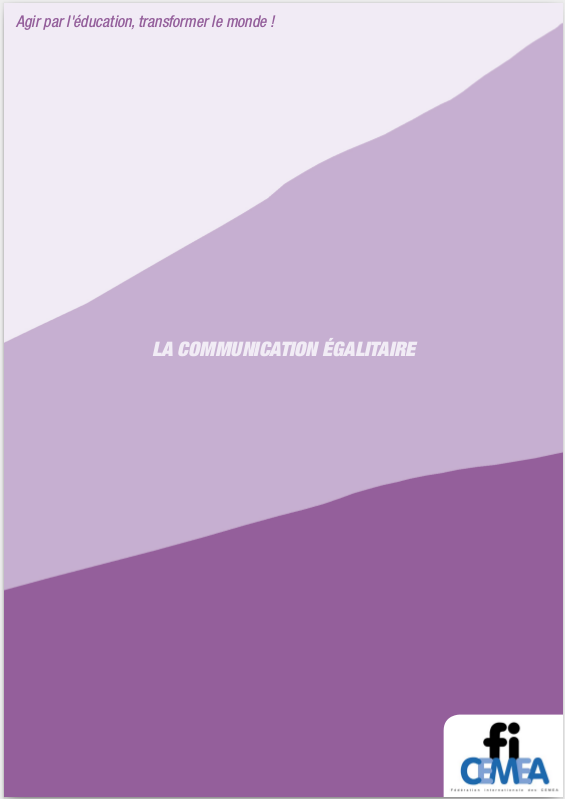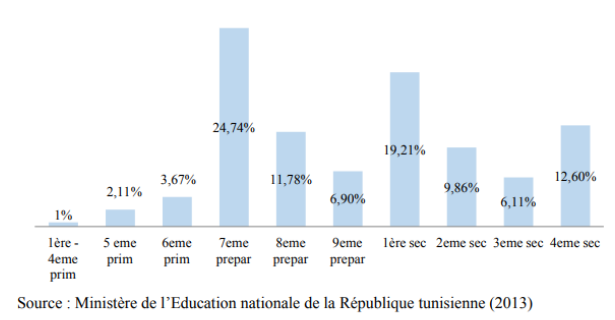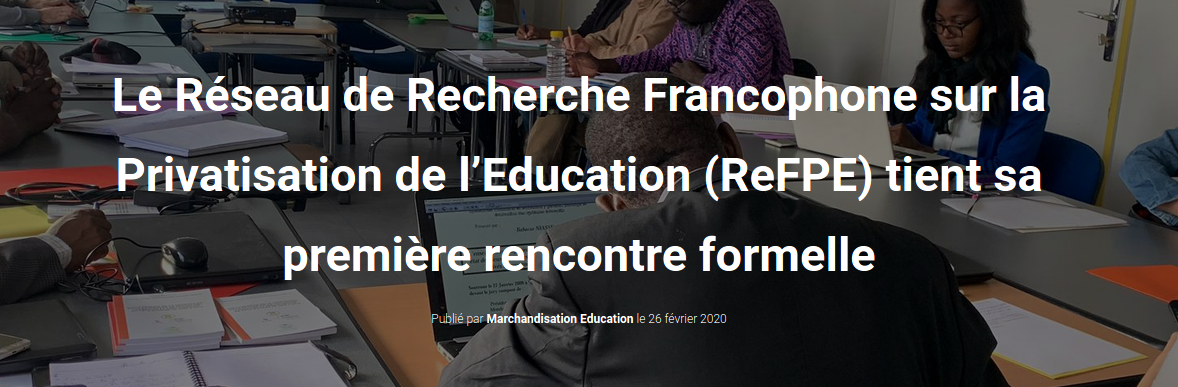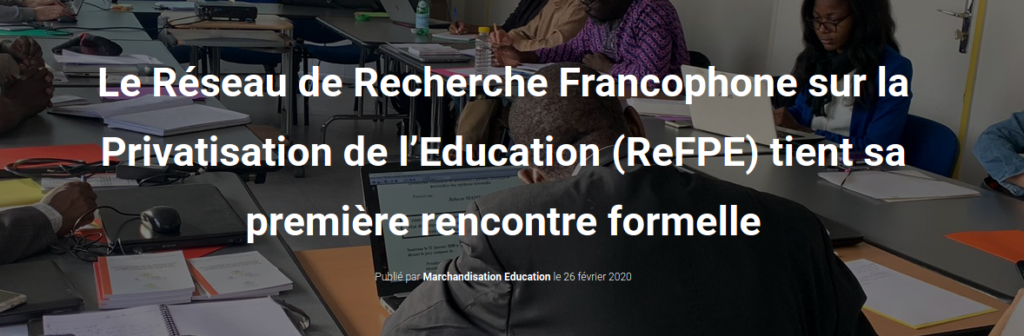Depuis le mouvement de refondation qu’elle a entamé au début des années 2010, la Ficeméa a organisé trois assemblées générales de ses membres : en 2014, 2017 et récemment, à Liège(Belgique), du 11 au 13 février 2020. Ces réunions n’ont rien de rencontres protocolaires. Il y a d’abord les retrouvailles qui engendrent et nourrissent des échanges chaleureux entre les membres pendant toute la durée de l’assemblée. Cette ambiance donne le ton des moments de travail intense et constructif dans lesquels chaque membre est impliqué.e.
Je veux souligner qu’il n’est vraiment pas anodin de se retrouver dans un temps limité pour échanger de cette manière profonde, osant le doute et la critique comme mode d’approche partagée et cultivant la créativité de chacun .e : car il s’agit d’avancer ensemble, de trouver des solutions afin que vive ce mouvement rassembleur, et qu’il vive bien ! Nos méthodes, les valeurs qui les fondent ne sont pas étrangères à cela bien sûr. Mais chaque fois, il m’apparaît que nous ne nous étonnons pas assez de la force que nous dégageons, de l’intimité de nos relations c’est-à-dire de leur valeur intérieure profonde; que nous ne mettons pas assez en évidence ce qui a priori reste caché sous les apparences et qui gagnerait être révélé bien davantage.
Hicter M., « Démocratie culturelle ou démocratisation culturelle » (texte pour l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Athènes, Mars 1976 in Pour une démocratie culturelle. Bruxelles, Ministère de la Communauté française et Fondation Marcel Hicter pour la démocratie culturelle, 1980, p. 337. Les nouvelles formes de gouvernance que l’assemblée générale a décidé d’expérimenter pour les années à venir et que nous devons préciser par nos essais pragmatiques d’ici à notre prochaine assemblée générale prévue en 2021 sont réellement une belle opportunité pour définir et mettre en œuvre une nouvelle manière d’agir ensemble. Celle-ci tient compte des spécificités dans le fait d’aborder l’éducation populaire en fonction des réalités culturelles, sociales, politiques et économiques de chacune de nos organisations, réparties dans différentes zones géographiques du monde. Et ce travail permet aussi de continuer à bâtir, dans un incessant et vivifiant mouvement d’adaptation à la réalité, une fédération dont les bases sont humanistes, internationalistes et, rappelons-le, pacifistes.
L’assemblée
générale a confirmé les objets sur lesquels fédérer nos
activités, nos observations et nos recherches pédagogiques, nos
résultats, nos moyens d’agir pour transformer la réalité :
-
en
continuant notre vaste action contre la marchandisation
de l’éducation,
Les membres de la Ficeméa s’engagent à poursuivre et développer le plan de travail élaboré en novembre 2014 et en décembre 2017.
Notre
détermination à enrayer les processus de marchandisation de
l’éducation porte ses fruits. Nous sommes entendus et relayés
avec l’appui de nos partenaires de ce réseau francophone que nous
avons contribué à mettre sur pied. L’action est suivie de près
par les militants des Amis
du Belvédère
(Tunisie) et chaque organisation se renforcera en contribuant et au
plaidoyer et à cette lutte, en agissant au niveau national et en se
fédérant au niveau international.
-
En
poursuivant l’élaboration de réponses concrètes pour une
utilisation des technologies numériques qui brise l’asservissement
économique et surtout l’asservissement de nos pensées auxquels
veulent nous réduire les GAFAM.
-
Et
en développant la démocratie
culturelle par tous les moyens dont nous disposons.
Notre vocation de mouvement d’éducation populaire nous arc-boute sur l’une des propositions-piliers de Marcel HICTER, président de la Ficeméa de 1971 à 1979. Entre autres, il évoquait la démocratie culturelle en ces termes :
« La démocratie culturelle (…) affirme la pratique responsable à la fois des individus et des groupes dans la cohérence de la société globale par la solidarité des individus et des groupes. Cette société-là est alors une association d‘hommes libres luttant pour des objectifs communs dans la diversité de leurs convictions. La démocratie culturelle repose sur le principe que l’individu, dans l’action solidaire doit pouvoir développer en toute liberté l’ensemble de ses potentialités. Elle affirme pour tous les hommes des droits égaux et tend à créer pour chacun les conditions matérielles et spirituelles de l’exercice de ses droits ; elle vise à réaliser l’équilibre entre l’épanouissement individuel dans la liberté et la conscience active de la liaison de l’individu à sa communauté et à l’humanité toute entière. Il en résulte que la culture est action permanente de ’homme pour améliorer sa nature et son milieu et mise en commun des résultats de cette action.
(…)
Cela veut dire que cette société démocratique exige que chaque citoyen soit éduqué à la théorie et à la pratique de la démocratie. Cette éducation est une composante essentielle de la politique culturelle générale qui, dans une société en évolution permanente, part naturellement du principe général d’une éducation, elle aussi permanente et qui se concrétise par l’organisation d’un processus de formation intégrée, scolaire et extrascolaire, pour tous les individus de tous les groupes sociaux et de tous les âges1 ».
C’est un vaste programme certes et c’est un excellent programme cadre pour l’action des membres de notre Ficeméa !
Yvette Lecomte
Présidente de la Ficeméa
1
Hicter M., « Démocratie culturelle ou
démocratisation culturelle » (texte pour l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe, Athènes, Mars 1976 in Pour
une démocratie culturelle. Bruxelles,
Ministère de la Communauté française et Fondation Marcel Hicter
pour la démocratie culturelle, 1980, p. 337.