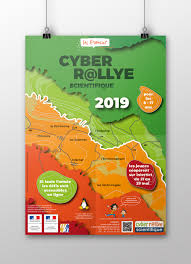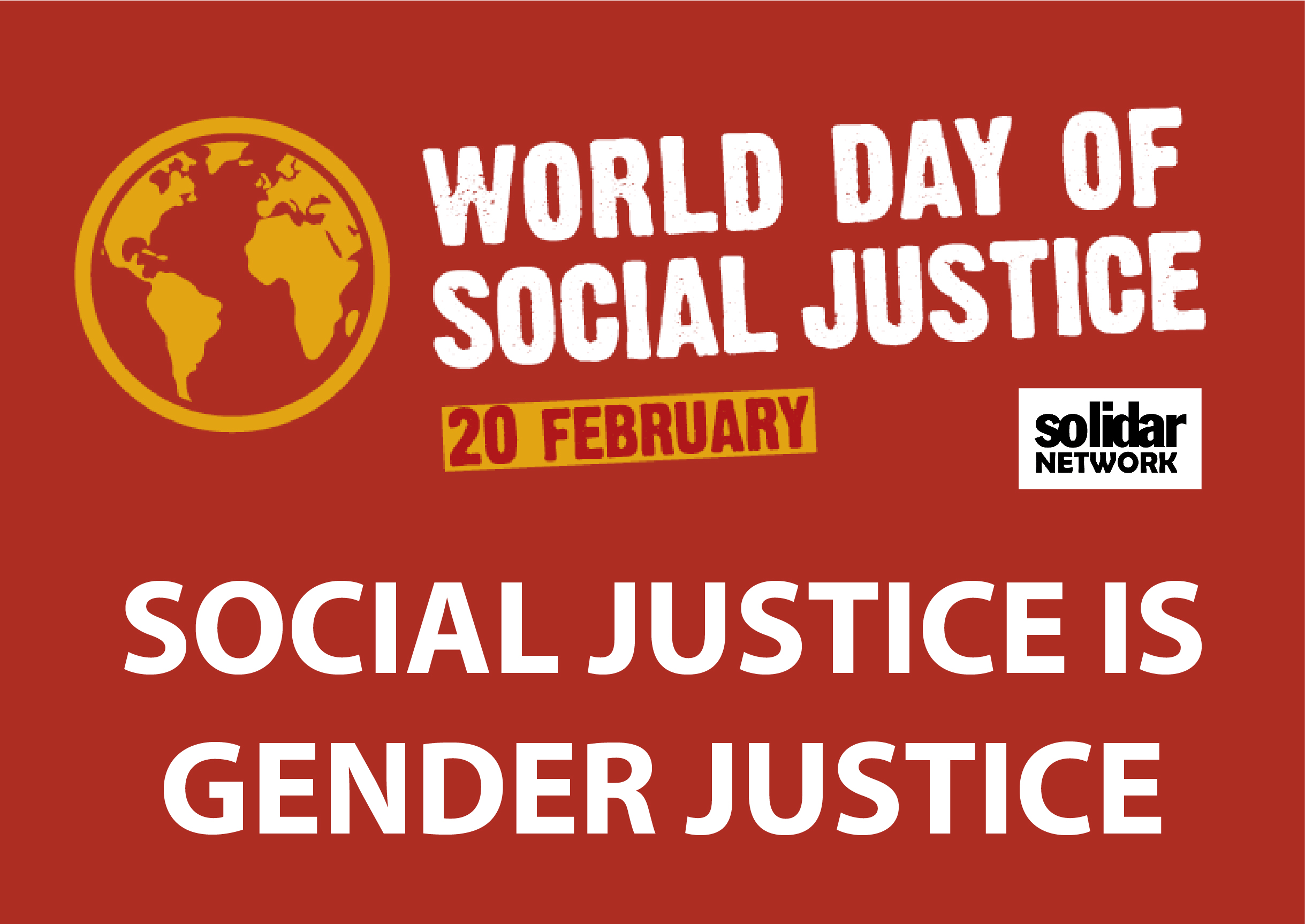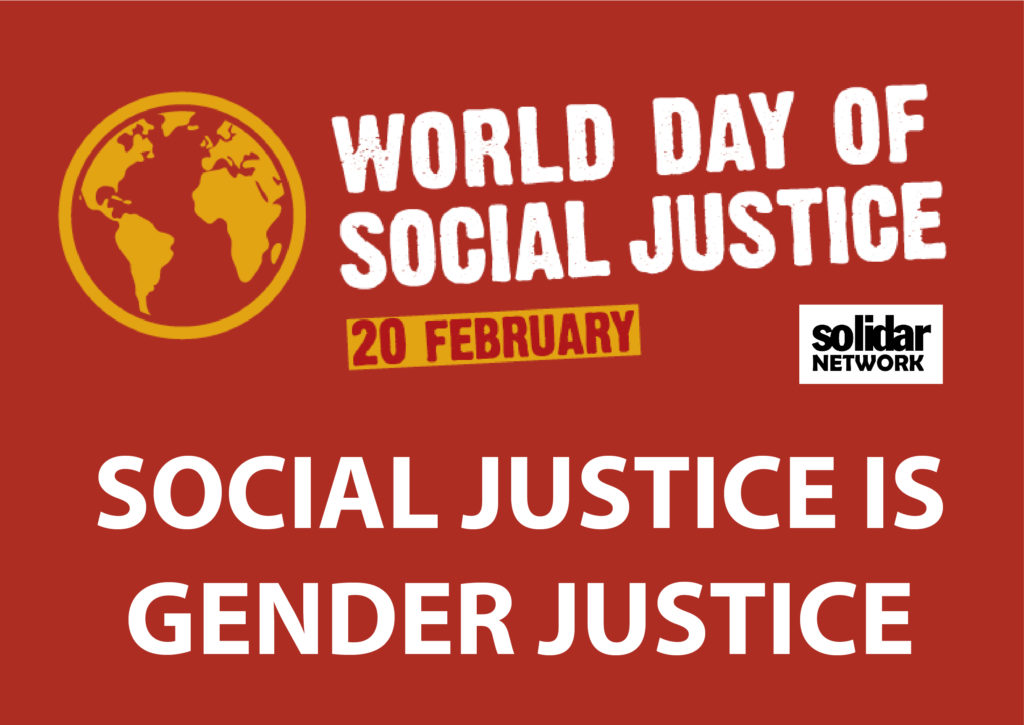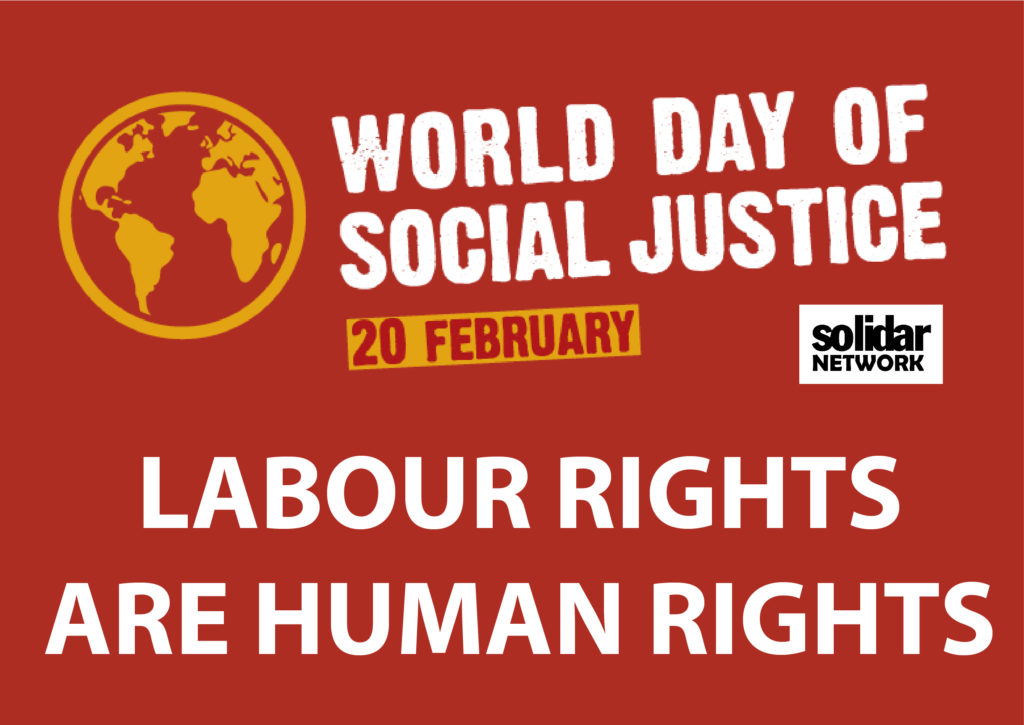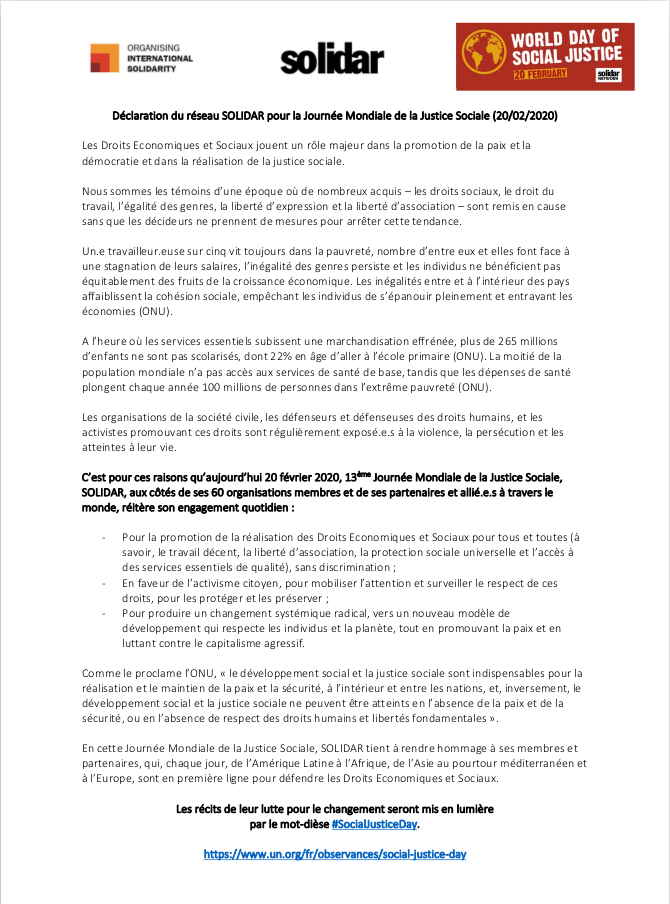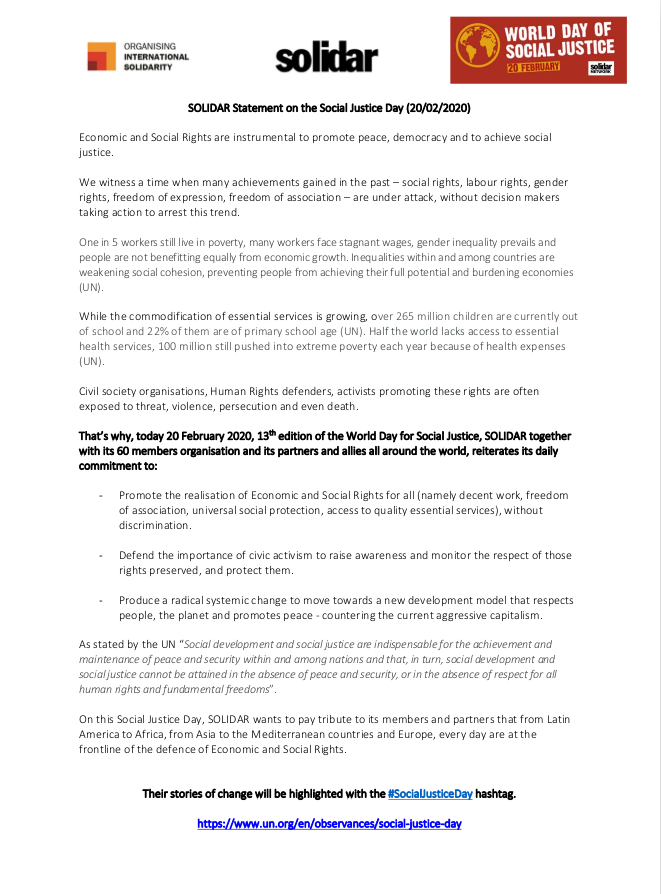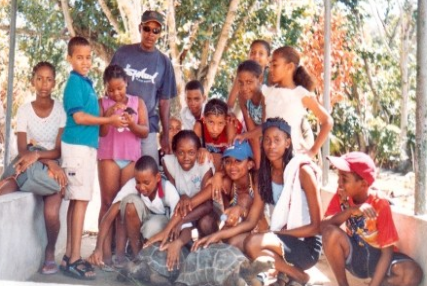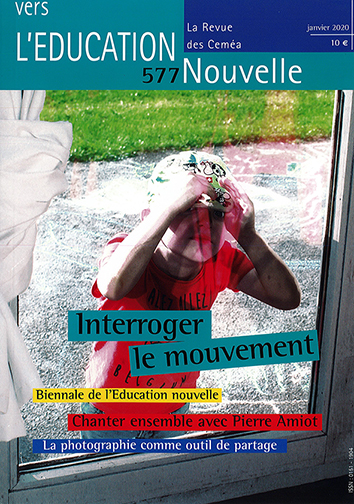
Extrait de l’article de François Simon – VEN 577« Toujours nouvelle l’éducation, oui mais pour qui ? »

Ce combat qu’il nous faut mener avec opiniâtreté contre la marchandisation des savoirs, qui avalise et consolide l’injustice en disant l’estomper est un autre de nos chantiers en cours, un combat pour freiner la puissance de l’argent (qui souvent aspire la raison d’être) dans le domaine de l’éducation et défendre le primat du sens.
Comment y faire face, c’est la question à laquelle Morgane Peroche (déléguée permanente de la FICEMEA), Luc Carton 1et Yannick Mével (CRAP Cahiers Pédagogiques) se sont efforcé·e·s de répondre, lors d’une table ronde.
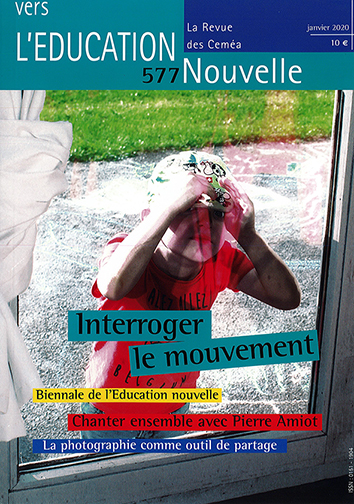
Force est de constater que l’éducation est devenue au fil des années une marchandise comme les autres dans le droit international où l’essor du secteur privé, soutenu par le droit international, s’est substitué au rôle de l’État. En Afrique de l’Est les ONG sont parvenues à fait plier l’État.L’éducation a été pensée et ce depuis Lisbonne en 2000 (conseil européen sur la connaissance) comme un facteur lambda de la croissance économique, ce qui a accru s’il en était besoin la légitimité mercantile de l’accès aux savoirs. Et pourtant Idriss J Aberkane2 qui a travaillé sur l’économie de la connaissance affirme que c’est un bien immatériel qu’on ne peut mesurer. En 2014, la FICEMEA s’est positionné sur 6 points :1/Réaffirmation des textes internationaux,2/Lutter contre désengagement états et soutenir les services publics pour la gratuité de l’ enseignement, 3/Rôle régulateur de l’État (justice sociale), 4/Reconnaissance de la société civile, 5/Place des différents acteurs éducatifs (présence des différents éducateurs et éducatrices : parents, enseignant.es, animateurs et animatrices…), 6/Émancipation des personnes et pratiques collectives. Points auxquels viennent s’ajouter en Octobre 2019 une lettre à la Banque Mondiale.
La FICEMEA, c’est aussi l’Appel Francophone contre la marchandisation de l’Éducation en 2017 à Dakar (création du réseau francophone contre la marchandisation de l’éducation : 6 organisations). Depuis, de nombreuses actions de plaidoyers ont été menées notamment la rédaction des Principes d’Abidjan3 qui disent bien le droit à l’éducation et mettent en avant et la primauté de l’enseignement public et la régulation de la privatisation de l’enseignement.
Le capitalisme informationnel tend à vider notre cerveau de son temps disponible pour le remplir de contenus monnayables. On a désincorporé la culture de la socio-économie. Le monde n’est pas présentable. Il est en pleine crise de représentation et truffé de séismes sociaux. Le savoir est démonopolisé et si les enfants le savent, les enseignant·e·s eux·elles pas forcément et c’est là que le bât blesse. Il y a ce gouffre creusé entre les tenants de la connaissance et qui la veulent indiscutable, chargés de la faire passer à des aboutissants, les élèves, qui la discutent déjà avant de la recevoir et c’est cette règle du jeu (la remise en cause est permanente : eh oui la terre est plate, et je vais vous le prouver) qui labellise aujourd’hui un savoir. La vérité est une théorie comme une autre (et c’est difficile à avaler). Il y a là une alchimie impossible à obtenir, des correspondances ratées à chaque fois.
À l’hypermarché du savoir, on trouve de tout, c’est bien achalandé et l’alternatif a la cote sur les étals ; dans l’éducation le secteur marchand ne vend pas des carottes mais de la connaissance « et regardez msieurs-dames cette belle pièce de mathématique toute fraîche, cette tranche d’histoire jamais révélée. ». La concurrence joue à plein. Mais il y a des constantes dans chaque tendance. Tout d’abord une critique très forte de l’école telle qu’elle existe, des finalités très claires et affirmées d’un engagement affiché, une promesse d’efficacité et enfin la promotion de choix individuels (à noter que personne ne le revendique et tout au plus certains le minimisent). L’économie de la connaissance est dangereuse , elle a pour but d’augmenter le profit.
il y a prolifération, déferlante, ce qui peut conduire à une certaine confusion et à un amalgame qui peut s’avérer néfaste aux mouvements qui développent des projets d’éducation nouvelle.
Chacun·e s’octroie et s’approprie des méthodes dites innovantes (alors qu’elles ont déjà fait leurs preuves dans maintes situations d’éducation), mal comprises et souvent utilisées à contresens. L’empowerment, imposture colonisatrice et pilleuse de méthodes établies qu’elle a fait siennes frauduleusement, est passé par là.
Au milieu de cette jungle des savoirs consommables (innombrables et de plus en plus dématérialisés), qu’en est-il des propositions d’éducation nouvelle, noyées dans un maelström où grouille tout et son contraire ? Qu’en est-il de l’actualité de la démocratie culturelle (fleurie en Belgique surtout) ? Et du projet (défendu par Marcel Hicter4) de rendre la société plus consciente d’elle-même ? Après le burn-out, le bore out, le brown-out menace. Mais nous ne sommes pas encore out, knock-out !
Plus que jamais et c’est une urgence, l’enseignement est appelé à devenir un métier coopératif, se rapprochant de l’éducation nouvelle et de la pédagogie institutionnelle. C’est un défi à relever dont nous ne pouvons nous désintéresser. Qu’est-ce qui empêche les enseignants à payer les élèves en fausse monnaie, en monnaie de singe ? Personne ne les empêche de libérer leurs liens, mais pour cela il y a besoin d’un raz de marée collectif et unanime si on veut tsunamier l’anémie des pouvoirs.
Marcel Gauchet5 disait dans « le débat » : « l’école est aujourd’hui à l’école d’elle-même », il faut absolument réfléchir à la signification du métier d’enseignant·e et ça nécessite un travail sur la connaissance. l’école ne doit pas, ne doit plus rester seule. J’ai souffert (dit Yannick Mevel) de voir deux dissociations s’opérer, celle de l’éducation nationale et de l’éducation populaire puis celle de cette dernière et de la culture. Approfondir la démocratie est un projet capital. La pédagogie est un moyen d’y parvenir.
La différence entre les pédagogues et les marchands c’est que les premiers assument leur déséquilibre et refusent de tenir une quincaillerie aux rayons remplis d’outils clés en main.
Mais on est souvent coincés : pour exister et développer des projets d’éducation nouvelle, on est contraints de passer par des appels d’offre, de se frotter à la concurrence avec le secteur marchand et de rentrer dans le moule astreignant du mercantilisme. Et c’est rarement la pédagogie qui l’emporte au monopoly éducatif de l’économie capitaliste !
Et il y a des dérives perverses même au sein de démarches volontaristes et louables : panneaux publicitaires qui promeuvent les institutions qui intègrent les jeunes en mal de moyens financiers (Wisconsin), accès gratuit à la fac mais cours privés au sein du secteur public (Mozambique).
Le mot marchandisation nous entraîne dans un dédale, un labyrinthe de notions dont nous n’avons pas l’habitude et qui peuvent nous perdre, notre fil d’Ariane étant la pédagogie. Les politiques publiques prennent très mal la mesure de la situation mais il est rassurant de penser que l’état ne peut s’en sortir sans l’éducation populaire et le monde associatif, rassurant comme il est inquiétant qu’il y reste sourd et aveugle et ne veuille le reconnaître.
Un exemple qui prouve qu’en Europe et même entre deux pays proches il y a un héritage qui fait la différence. En Belgique nous sommes les héritiers d’une culture municipale ce qui conduit les pouvoirs publics à accorder le plus gros budget de la culture à l’éducation populaire et en France étant les héritiers d’une culture d’état, peanuts pour le monde de la gentille éducpop.
Nous vivons dans une société salariale et passons notre temps à fabriquer des services. Le salariat suppose de remettre sa force de travail à quelqu’un qui en dispose, la véritable éducation n’a pas de sens dans ce système. Il faut faire bouger le salariat, il faut à tout prix sortir de cette théorie où c’est la propriété qui détermine le pouvoir.
Il faut se méfier comme de la peste du glissement de terminologie : passer d’économie sociale à social business est lourd de sens. Et c’est ce qui est suspendu comme une épée de Damoclès au-dessus des projets politiques. Sachons-nous en prévenir.
François Simon
1 Luc Carton, philosophe, vice-président de l’Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg (Suisse), chercheur associé auprès de l’Association Marcel Hicter pour la démocratie culturelle (Bruxelles)
2 Le problème de cette personne c’est qu’elle instrumentalise complètement la notion d’éducation. Oui il affirme que la connaissance est un bien immatériel, que l’on ne peut mesurer et que l’on peut accumuler sans limites sauf que pour lui l’accumulation de connaissances doit pouvoir permettre aux individus et donc aux nations de s’enrichir davantage. En gros, pour lui, il ne faudrait pas mesurer un taux de croissance économique par le pétrole (bien matériel) mais par l’accumulation de connaissances. Plus une nation accumule de la connaissance, plus elle est compétitive. Nous sommes donc toujours dans une logique libérale de croissance économique et augmentation des richesses. Les propos de cet homme sont très dangereux, puisqu’il utilise les termes d’« éducation active » et d’« émancipation »…. mais dans une démarche de pure accumulation des richesses. Nous ne pouvons bien évidemment partager ce point de vue.
3 Texte publié en mars 2019 sur les obligations des États en matière de droits de l’Homme de fournir un enseignement public et de réglementer la participation du secteur privé dans l’éducation .
4 Homme politique et écrivain wallon, président de la FICEMEA de 1970 à 1979
5 Philosophe et historien français