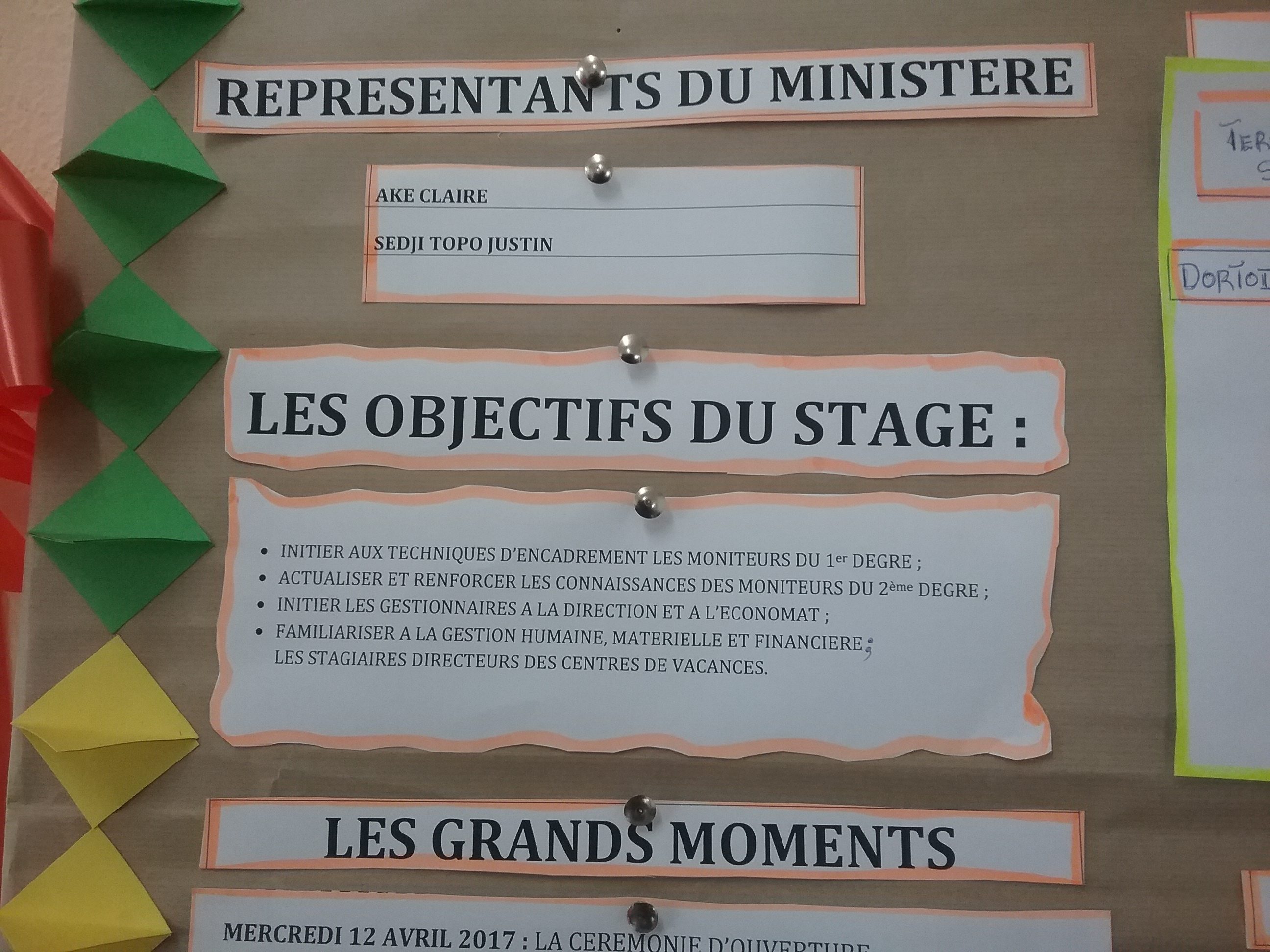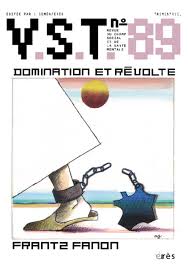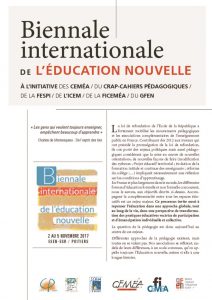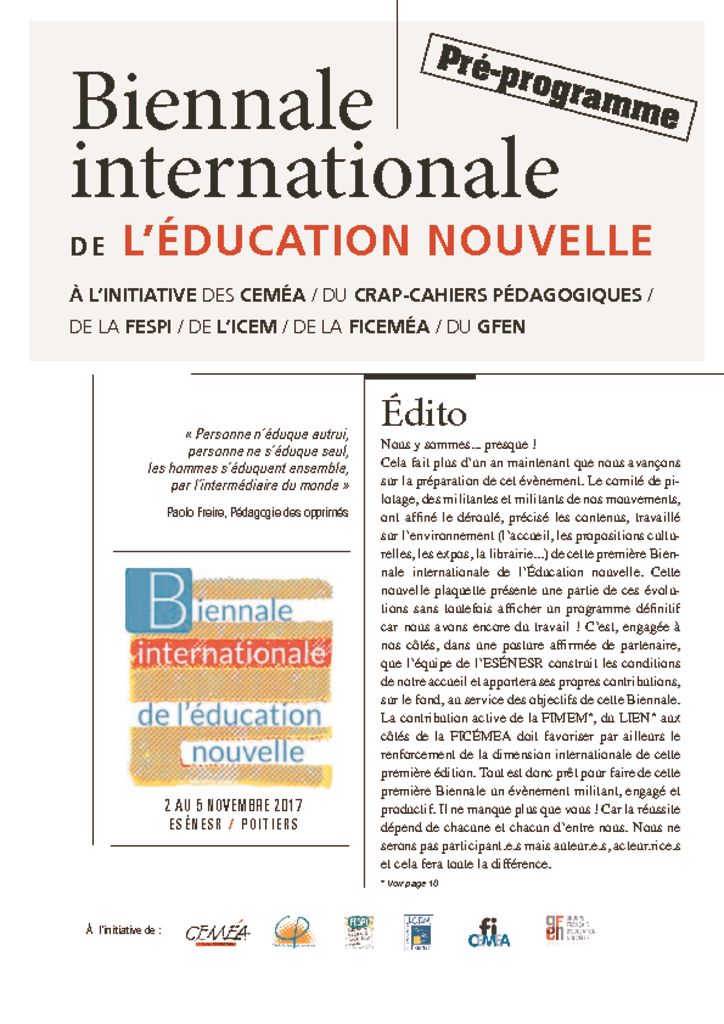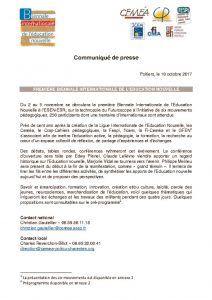L’éducation est un terrain de jeu mondial fructueux pour les grands groupes du numérique nommés les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et d’autres en quête de nouveaux marchés à conquérir. Cette transformation des systèmes éducatifs touche tous les pays du monde.Face a ce phénomène, la fonction de l’État devrait être de réguler les services éducatifs, de s’assurer que ces nouveaux supports et usages numériques bénéficient à l’intérêt public, aux services des élèves des professeur.e.s et des acteurs socio-éducatifs. Ce faisant, les usages du numérique devraient s’inscrire dans une politique publique en tant que bien commun.
L’exemple de ce qui se passe actuellement en France illustre tristement cette dérive mondiale et est de nature à sonner une nouvelle fois l’alarme ! Le ministère de l’éducation nationale français propose cette semaine de donner accès aux données numériques des élèves et des enseignant.e.s aux GAFAM.
Ainsi, il deviendrait le partenaire de ces groupes et ouvre les portes à l’introduction des GAFAM dans l’institution scolaire. Mathieu JEANDRON, Directeur du Numérique pour l’Éducation au ministère autorise à travers une lettre adressée aux Délégués Académiques du Numérique (DAN) la connexion des annuaires de l’institution avec les services Google !1
Comme indiqué dans l’article du Café Pédagogique, «L’enjeu, ce sont les données des élèves. Les entreprises auront accès aux annuaires des établissements et aux informations nominatives sur les élèves et les enseignants. Elles pourront suivre les déplacements et redoublements des uns et des autres, voir ce que le professeur X utilise comme ressource ou ce que fait l’élève Y. Ces données seront une manne pour le ciblage publicitaire ou pour revendre des informations à des partenaires». L’objectif sous-jacent est de développer des «pédagogies » inscrites dans une volonté de profit, de produire de futurs consommateurs de produits. Cette tendance est déjà hélas largement à l’œuvre dans de nombreux pays du monde. Lire à ce sujet l’excellent article de Natasha Singer «How google took over the classroom» dans le New York Times.2
M. JEANDRON explique que tout ceci s’inscrit dans le cadre d’une charte de confiance décrite comme un «pacte de confiance portant sur l’engagement de la protection de la vie privée des élèves et des enseignants ». Cette charte est certes au travail mais n’existe pas pour le moment, la CNIL interpellait d’ailleurs il y a peu sur l’urgence « Il est temps de mettre un cadre à toutes ces offres économiques » insistant sur le fait que « ce document devait être un outil contraignant (circulaire ou autre), robuste. Sur ce point-là, nous n’avons aucun élément de réponse à ce stade. »34
Si ce courriel de M.JEANDRON devait devenir une circulaire, ce serait, après l’accord Microsoft5, une ouverture grave de l’éducation aux marchés et un abandon coupable de la protection que l’État doit à ses citoyens.6
Nous assistons actuellement, à l’échelle mondiale, à la substitution des financements publics (nationaux et internationaux) par des financements issus de partenariats confiés à des sociétés privées qui ont plus des objectifs de profit que des visées d’éducation de la population. La tentative globale d’inclure l’éducation dans la sphère des rapports marchands n’est pas nouvelle. Mais l’irruption du « numérique » a fait entrer ce processus dans une nouvelle ère. Elle ne vise plus seulement l’enseignement en tant qu’activité de service mais massivement les ressources et contenus éducatifs en tant que « produits pédagogiques ». Ceci inclut des « modèles d’éducation » dont nous savons qu’ils ne sont pas neutres et plus dramatiquement encore la collecte et la privatisation de données précieuses à exploiter ! Selon les principes de l’appel des réseaux internationaux contre la marchandisation de l’éducation « L’État doit garantir que l’éducation ne soit pas instrumentalisée par les acteurs économiques et que soient appliqués les principes soutenant la démocratie tels que les principes de transparence, participation et responsabilité.
En analysant cette nouvelle orientation politique du ministère l’éducation nationale français sous le prisme de ces trois principes nous constatons que le processus marchand à l’œuvre est en contradiction avec l’idéal démocratique que nous défendons.
Transparence
L’ouverture au GAFAM contredit l’idéal de transparence de par le flou concernant l’utilisation des données des élèves et des enseignant.e.s par les groupes numériques. La récolte des données est une arme économique majeure. Cette récolte est stockée hors des frontières de collecte, posant la question majeure de la souveraineté des données. Les informations récoltées peuvent ensuite être vendues ou échangées dans une totale opacité pour les citoyen.ne.s. En laissant les GAFAM s’immiscer dans les pratiques des élèves dès le plus jeune âge, ces grands groupes ne les considèrant pas comme des apprenant.e.s mais de futur.e.s consommateurs.trices, l’Etat les rend vulnérables en ne jouant pas son rôle de régulateur.
Participation
Le numérique est et doit demeurer un support, un outil au service d’un projet pédagogique. Il ne faut pas confondre l’outil et la finalité de cet outil. Ce qui prime c’est la relation pédagogique, la construction du savoir par les élèves, la formation des enseignant.e.s, des acteurs.trices socio-éducatif.ve.s mais aussi la relation que les élèves créent avec les outils numériques en dehors de l’asservissement.
Les usages numériques transforment profondément les pratiques pédagogiques. Or, nous devons nous réapproprier ces outils, ces données pour en faire un bien commun accessible à tous et toutes.
Responsabilité
L’introduction du numérique par les GAFAM dans l’institution scolaire met en péril la question de l’appropriation par les citoyens.ne.s. Le numérique est envisagé comme un espace réservé aux expert.e.s et le grand public ne se considère pas armé pour comprendre, analyser les enjeux actuels.
La responsabilité de l’État est d’offrir un cadre de régulation, de protéger les citoyen.nes, d’introduire une réflexion critique.
Dans ce contexte international, nous militons pour la prise en compte dans le débat public (national, européen et mondial) des sujets liés au numérique comme objets intégralement politiques, sociétaux et philosophiques. Nous soutenons que le rôle des États est d’encourager et garantir les services, les logiciels et les écosystèmes qui donnent aux individus une capacité de critique, de conserver et d’accroître leur souveraineté numérique individuelle. Il est urgent d’informer les citoyen.ne.s sur les dérives en cours, réintroduire une critique de la question numérique par la formation et de sensibiliser à l’usage des logiciels libres, des services en ligne loyaux, décentralisés, éthiques et solidaires.
1 -Voir article du Café Pédagogique, 16 mai 2016, François Jarraud.
2-Voir article de Natasha SINGER dans le New York Times
3-Pour la CNIL, “la France doit garder la souveraineté de ses données scolaires”
4-Communiqué du 22 mai de la CNIL
5-Voir le texte de l’accord Microsoft-Ministère de l’Éducation.
6-TV5 Monde : «Éducation nationale, les données scolaires bradées aux GAFAM ?
Contacts presse : CEMEA France : pascal.gascoin@cemea.asso.fr
FICEMEA : ficemea@cemea.asso.fr
Premiers signataires
ABULEDU-FR https://abuledu.org
ACCP (Espagne) http://www.acpp.com/
AFOUL https://aful.org/
APRIL http://www.april.org
asbl RTA http://www.rta.be/
Association Nationale Scientifique de Jeunes ”Découverte de la Nature” Algérie.
CAEB http://www.caeb-benin.com/
CASAD-Bénin
CEDEM http://lecedem.org/
CEMEA Belgique http://www.cemea.be
CEMEA Burkina Faso
CEMEA France http://www.cemea.asso.fr
CEMEA Russie
CEMEA Suisse : http://formation-cemea.ch/
CEMÉA Suisse du Tessin : http://cemea.ch/
Collectif des travailleur·se·s précaires de l’ESR : https://precairesesr.fr/
Education&Devenir http://educationetdevenir.fr/
EEDF http://www.eedf.fr
FCPE https://www.fcpe.asso.fr
FG PEP http://www.lespep.org/
FICEMEA http://www.ficemea.org
FRAMASOFT : https://framasoft.org
Guépier d’Afrique (RD Congo)
ICEM www.icem-pedagogie-freinet.org
JEVEV ONG http://ongjevev.wixsite.com/ong-jevev
Le Planning https://www.planning-familial.org/
Le Réseau Ivoirien pour la Promotion de l’Education Pour Tous (RIP- PT) http://www.ripept.org
PAPDA (Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif)
UNAFETPCI Union Nationale des Formateurs de l’Enseignement technique et Professionnel de Côte d’Ivoire