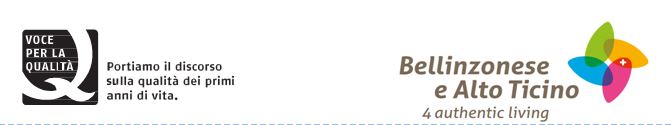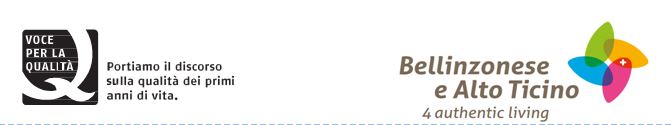
Par les Ceméa de Suisse (Tessin) – Bellinzona, 24 mars 2017
La prime enfance, cette phase de la vie allant de la naissance à l’entrée à l’école, est au cœur d’une exposition‑événement qui se déroule près de Castelgrande, à Bellinzona, du 25 mars au 25 juin 2017. Plus de 90 événements sont prévus sur l’ensemble du territoire du canton au cours des trois mois de l’exposition. C’est donc dire l’importance accordée à la garde éducative dans la Suisse italienne et la diversité des services offerts.
L’exposition tire son origine des études menées à l’échelle internationale qui soulignent l’importance primordiale des premiers mois et des premières années de vie. Une importance qui se reflète à tous les points de vue, non seulement sur la vie scolaire, mais également sur la vie sociale et professionnelle. Un enfant évoluant dans un environnement propice au développement de son potentiel sera plus à même d’affronter un monde complexe se transformant rapidement, à l’image de celui d’aujourd’hui et de demain.
Cet état de fait comporte également des conséquences de nature économique et financière. Un environnement de bonne qualité au cours des premières années de vie est associé à une réduction substantielle des disparités que l’école seule ne parvient pas à atténuer. Une plus grande équité, un moins grand recours à des mesures correctrices, un plus faible taux d’échec et une meilleure intégration se traduisent par des coûts moindres et des retombées positives plus importantes. Voici quelques‑unes des pistes de réflexion proposées par la Commission suisse pour l’UNESCO au cours des dernières années.
En 2009, la première étude sur la prime enfance en Suisse, mandatée par cette Commission, a vu le jour. Les résultats ont mis en lumière le fait surprenant que la Suisse accuse un retard, à l’instar d’autres pays, justement dans une étape aussi importante du système éducatif.
Plus particulièrement, il manquait — et il manque toujours — des critères communs d’appréciation des besoins réels de l’enfant; par conséquent, il n’existe pas une définition de la qualité de l’environnement familial et institutionnel. Il en va de même pour le profil des éducateurs qui exercent dans des structures d’accueil (jardins d’enfants, familles d’accueil de jour, groupes ludiques, etc.) et de leur formation. En dépit du fait que beaucoup a été accompli pour promouvoir la formation (de base ou continue) du personnel, il y a encore une abondante matière à réflexion et à discussion à bien des égards (contenus, titres, pratiques, liens avec la recherche, etc.). Ce qui particularise la situation en Suisse, c’est son caractère hétérogène. Selon l’étude en question, même le lien entre la prime enfance et l’école serait une facette rarement explorée.
S’il est vrai qu’il reste encore beaucoup à faire du point de vue qualitatif, des progrès ont cependant été réalisés du point de vue quantitatif.
Les statistiques renseignent peu sur la qualité
Au cours des treize dernières années, la Confédération suisse a mené des interventions financières et législatives ciblées en matière de garde de la prime enfance. Ainsi, plus de 50 000 nouveaux postes ont été créés pour la garde des enfants. Dans le Tessin, 827 nouveaux postes ont été créés dans les jardins d’enfants et 363 dans des structures d’accueil extrascolaire. Les résultats des études scientifiques révèlent que près des deux tiers des ménages tessinois avec au moins un enfant de 0 à 4 ans se tournent vers des services ou des aides pour la garde. Les études précisent la répartition suivante : aucune garde extrafamiliale (40 %), garde confiée aux grands‑parents (20 %), jardin des enfants (14 %), services de garde formels (12 %), services de garde informels (9 %) et enfin, garde auprès d’une famille de jour (5 %).
Il faut discuter de la qualité
En 2012, l’association La voix pour la qualité a été créée afin d’informer et d’engager tous les acteurs touchés, directement ou indirectement, par cette thématique sociale. Elle regroupe 35 organisations de toutes les régions linguistiques. Par l’entremise de l’exposition itinérante, l’association vise à susciter des discussions à propos de la qualité de la formation, de l’accueil et de l’éducation de la prime enfance en Suisse. L’exposition sera présentée dans sept localités de la Suisse, Bellinzona constituant la première étape.
Une exposition‑événement accompagnée d’une riche programmation
L’exposition‑événement de Bellinzona a réussi à susciter un grand intérêt dès sa préparation. Plus de 90 événements, manifestations et débats ponctueront les trois mois au cours desquels se déroulera l’exposition. Ce sera l’occasion pour le canton de « redécouvrir » la prime enfance.
D’où le titre emblématique de l’exposition : « La découverte du monde ». En réalité, l’exposition tente, au moyen d’expériences, de données et de stimuli variés, inspirés des connaissances neurologiques et psychologiques les plus récentes, d’inciter le visiteur à découvrir la construction mentale et affective par l’enfant d’une vision du monde. Toutefois, « La découverte du monde » concerne aussi le monde mental de l’adulte. À cet égard, la vision des adultes de l’enfant à l’étape de la prime enfance a bel et bien changé.
Tous les enfants depuis leur naissance se lancent à la découverte du monde en avançant à tâtons, en saisissant des objets, en touchant, en rampant, en marchant et en apprenant à parler. Les parents, la famille, la fratrie et les autres personnes de référence les accompagnent et les encouragent. Mais quelle est la valeur du jeu? Quel est le rôle des parents, des grands-parents, des éducateurs? Quelle est la position de l’État, des organisations publiques et privées? Quelle réponse apporter à une société qui exige une grande conciliation travail‑famille? Quel est le lien avec l’école? Voici, entre autres, quelques‑unes des questions soulevées par l’exposition et les manifestations régionales.
Les enfants sont bienvenus à Bellinzona. En effet, l’exposition a prévu diverses façons pendant l’ensemble de la visite pour les stimuler et les faire participer.
Au cours des week‑ends, des étudiants seront présents pour informer les visiteurs et décrire les caractéristiques de l’exposition. Ces étudiants ont reçu une formation professionnelle dans le domaine sociosanitaire des organismes suisses suivants : École spécialisée pour les professions sanitaires et sociales (SSPSS), Centre professionnel social Mendrisio (CPS) et Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI). Il est possible d’obtenir le guide de présentation de l’exposition.
L’Organisation touristique régionale de Bellizona et du Haut Tessin est heureuse d’accueillir cette exposition à Castelgrande. Les châteaux, c’est connu, sont des lieux magiques pour les tout‑petits. Castelgrande devient pour l’occasion un lieu propice aux découvertes. Une enrichissante collaboration a pris naissance entre les divers partenaires tessinois concernés par ce thème. Elle permettra d’accueillir à nouveau dans les châteaux les visiteurs locaux, les familles, les touristes qui s’émerveilleront « comme des enfants » devant la grande beauté de notre région.
La voix pour la qualité
L’association La voix pour la qualité a été fondée en 2012. Elle vise à rendre public le discours sur la qualité de la formation, de l’éducation et de l’accueil de la prime enfance et à en dégager la signification pour notre société. La voix pour la qualité est une plateforme de communication, d’information et d’échange sur le thème de la qualité dans la prime enfance. Nos membres sont des organisations et des instituts de recherche soucieux de la qualité et actifs dans le domaine de la formation, de l’accueil et de l’éducation de la petite enfance.
www.voce-qualita.ch
Le concept de l’exposition
L’exposition « La découverte du monde » permet de découvrir le regard que portent les enfants sur le monde. Quels sont les besoins des tout‑petits au cours des premières années? Comment apprennent‑ils, comment jouent‑ils et comment communiquent‑ils ? Que peuvent faire les adultes pour les accompagner de façon optimale dans leur développement?
À première vue, cette thématique, un peu abstraite, recèle un potentiel scénographique et narratif. C’est une thématique qui touche tout un chacun : parents, grands‑parents, marraines, parrains, mais aussi les citoyennes et les citoyens. La thématique et le public cible ont incité la mise sur pied d’une exposition qui accueille les enfants comme visiteurs, en les considérant comme un groupe particulier avec des exigences bien précises. Comment alors concevoir la scénographie d’une exposition de façon à ce que les adultes et les enfants s’en sentent parties prenantes? Est-il possible de satisfaire les exigences des tout‑petits en créant des aires autonomes? Autrement dit, de considérer l’exposition comme un « lieu de l’apprentissage » pour les tout-petits?
L’exposition « La découverte du monde » propose un parcours qui mise sur l’innovation non tant de sa conception architecturale que dans sa scénographie, grâce à l’aménagement d’un environnement de jeu et de découverte. Les enfants sont invités à explorer ce paysage et à participer à sa construction. Les tapis de jeux de couleurs peuvent par exemple être assemblés pour devenir des glissoires, des grottes ou des murs et ainsi transformer sans fin l’espace architectural.
D’autres éléments de l’exposition sont mis à la disposition des enfants pour donner naissance à d’autres initiatives. Par exemple, dans la partie introductive, à travers le récit d’histoires du passé, il est possible d’actionner des moulins à vent ou encore d’écouter des boîtes à musique — plusieurs de ces objets évoquent les souvenirs de notre enfance.
En d’autres endroits de l’exposition, le regard des enfants donne lieu à de véritables scénographies — par exemple, au début du parcours, la présence d’une entrée de très petite dimension transforme le tout‑petit en protagoniste de l’exposition. L’interaction est au rendez‑vous. Ainsi, au moyen du lancer de dés, on active une piste de billes qui déclenche à son tour une animation où les sons et les images en sont les éléments magiques.
La boule de bois colorée, remise à tous les visiteurs au début de l’exposition, a pour effet de rapprocher les adultes et les enfants. La boule favorise l’interaction entre les visiteurs à plusieurs endroits de l’exposition. Le recours à la boule comme élément de jeu, voire comme instrument d’interaction pour donner accès à certains contenus, en fait un objet à découvrir et à redécouvrir.
Pour plus d’information en Français, italien et Allemand :
http://decouvrir-le-monde.ch/fr/bellinzona/home/
Exposition‑événement « La découverte du monde »
Castelgrande, Bellinzona
Du 25 mars au 25 juin 2017
Heures d’ouverture : lundi à dimanche : 10 h à 18 h Droits d’entrée :
Adultes : 10 CHF
Tarifs réduits : 5 CHF (aînés, enfants de 6 à 14 ans, étudiants sur présentation de la carte)
Familles : 15 CHF (avec des enfants de 14 ans et moins)
Entrée libre pour les enfants de 6 ans et moins
Groupes : 5 CHF/personne (écoles, écoles maternelles, garderies crèches, jardins d’enfants, centres d’accueil extrascolaire, etc. avec une entrée libre pour 2 accompagnateurs)
Visites guidées : 90 CHF (maximum : 30 personnes)
Personnes-ressources pour de plus amples renseignements :
Dr Dieter Schürch, professeur
Membre du comité de l’association La voix pour la qualité et membre de la Commission suisse pour l’UNESCO
079 691 07 81
dieter.schuerch@myliss.ch
Paolo Bernasconi
Responsable de l’association La voix pour la qualité
091 630 28 78
ticino@voce-qualita.ch
Bellinzonese e Alto Ticino Turismo Palazzo Civico, 6500 Bellinzona 091 825 21 31
bellinzona@bellinzonese-altoticino.ch www.bellinzonese-altoticino.ch
www.scoperta-del-mondo.ch