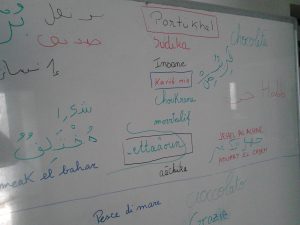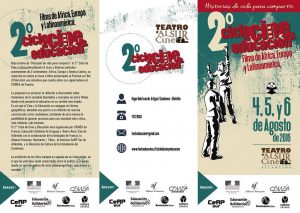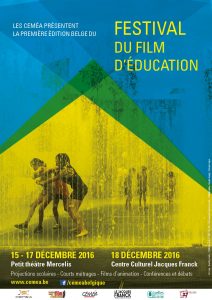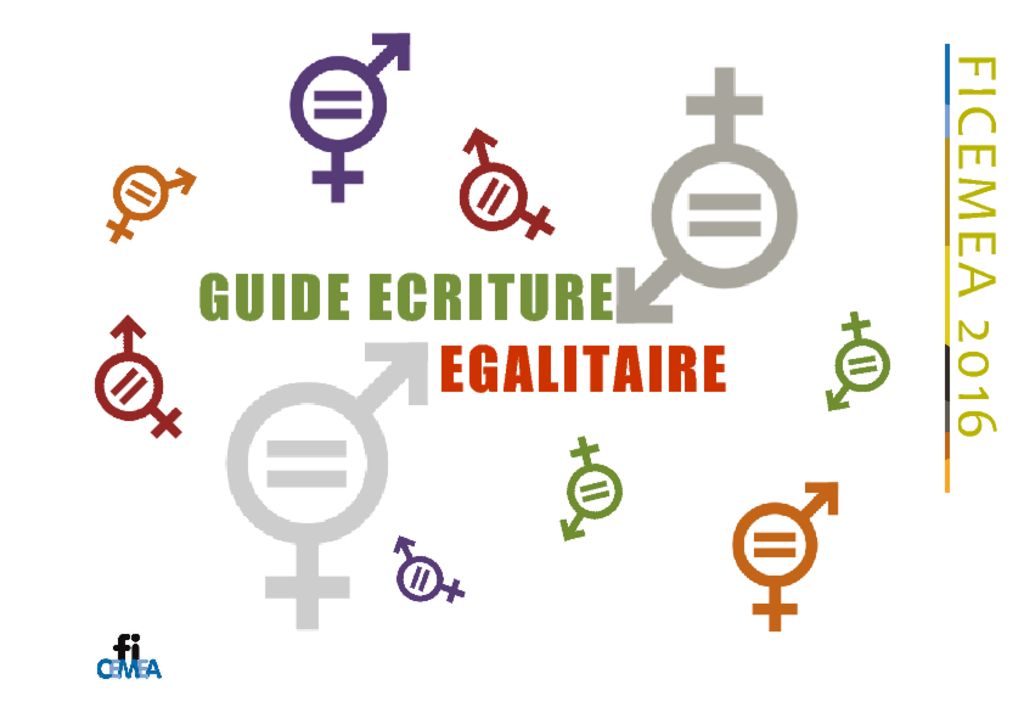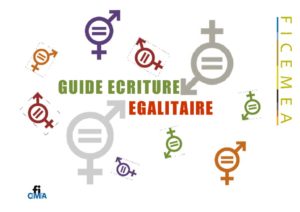Par l’association Right to Education Project (RTE)
Le partenariat public-privé (PPP) est un terme général qui fait référence aux arrangements entre un gouvernement et un ou plusieurs acteurs du secteur privé pour offrir un service, dans ce cas, l’éducation. Cet arrangement est habituellement officialisé par un contrat qui précise, entre autres, la nature du service, la durée de l’offre, les risques et les frais que chaque partie prendront en charge. Les services offerts par ces PPPs varient, ils peuvent compter: la gestion, la maintenance, les infrastructures, les services de soutien tels que les transports, les repas scolaires, le ménage, la sécurité, etc.
Cette définition étant très vaste, je vais me concentrer sur le type de PPPs dont l’actuelle croissance inquiète le plus les communautés des droits de l’homme et de l’éducation: les PPPs où les acteurs du secteur privé gèrent les écoles (écoles sous contrat, écoles à charte, écoles libes, académies, etc.) et pour lesquelles le gouvernement paye pour que les élèves y étudient. Ce paiement peut-être effectué par des coupons, que les parents ou responsables utilisent dans les écoles de leur “choix”, ou il peut-être payé directement à l’école sur la base de la fréquentation (par têtes). Cela peut couvrir la totalité des frais de scolarité ou les subventionner. Les coupons peuvent être universels (pour tous les élèves) ou précis, ne concernant que certains élèves, certaines écoles et zones géographiques.
Bien que le droit international des Droits de l’homme ne spécifie pas qui devrait être le faiseur d’offre direct pour les services en éducation (CESCR, GC 3, §8), il indique que les Etats ont une responsabilité principale dans l’offre directe de l’éducation dans la plupart des circonstances (CESCR, GC 13, §48). Le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation a clarifié que quelque soit le faiseur d’offre: ” L’état demeure le garant et le régulateur du doirt à l’éducation” (§121). Il a souligné que les PPPs ne doivent pas empêcher l’accès à l’éducation de qualité pour tous et gratuite (§123), et l’état doit régulariser et faire le suivre des PPPs (§128) et alloué un maximum de ressources disponibles pour la mise en oeuvre du droit à l’éducation (§48). Pareillement, un traité de pratique et jurisprudence émergent suggère que bien que le financement public des écoles privées existe, il peut, en général, ne pas être la seule solution ou dominer pour tout un pays (Committee on the Rights of the Child’s recommendations for Brazil or Chile in 2015).
Bien que les autres modèles de PPPs peuvent promouvoir le droit à l’éducation, dans la section suivante, je vais analyser le potentiel des PPPs, en me concentrant sur les coupons universels, pour promouvoir ou violer le droit à l’éducation en utilisant cinq critères que nous avons développé pour évaluer la conformité des fournisseurs en éducation privée avec les droits de l’homme.
1. Engendrent-ils discrimination ou ségrégation, ou engendrent-ils une hausse dans les inégalités?
En théorie, s’ils sont bien conçus, réglementés et suivis, les PPPs ne doivent pas discriminer ou augmenter les inégalités. Cependant, un des exemples de PPPs les plus connus, celui du système de coupons au Chili a démontré de grandes inégalités (clairement exprimées dans les résultats PISA), de la ségrégation ainsi que des pratiques discriminatoires dans les admissions scolaires (telles que le certificat de mariage des parents, des certificats religieux, etc.). C’est pour cela que le Comité pour les droits de l’enfant a critiqué les hauts degrès de ségrégation et les differences de qualité de l’éducation au Chili.
De la même façon, malgrè les hauts niveaux de responsabilité supposés de Milwaukee Parental Choice Program (MPCP), un programme de coupons aux USA, de nombreux chercheurs (Carnoy and McEwan, 2003; Molnar, 2001) avaient sonné l’alarme au sujet de la discrimination, particulièrement pour les élèves aux besoins particuliers.
Lorsque la réforme en éducation mondiale la plus longue dans la durée et la plus poussée qui comprenait des PPPs au Chili et que le système de coupoons aux USA démontrent ces résultats, on ne peut que se poser les questions suivantes: quelles sont les potentielles violations des droits de l’homme dans les états fragiles où la forme de gouvernement est questionnable, où la corruption est forte et le niveau de responsabilité pour les fournisseurs privés inefficace ou non-existante?
2. Mènent-ils à la seule option d’avoir des écoles primaires privées payantes, sont-ils optionnels et existent-ils en complément d’écoles publiques gratuites et de qualité?
De nombreux pays, surtout en Europe utilisent des formules de coupons pour soutenir la pluralité en éducation. Certains de ces PPPs amènent les élèves a être capables de choisir une école dirigée par des fournisseurs non-étatiques gratuitement, telles que certaines écoles religieuses au Royaune-Uni. D’autres pays subventionnent partiellement ces frais, tels que l’Espagne, et offrent aussi un système public vaste et solide qui offre une éducation gratuite. Ces formules ne violent pas le droit à l’éducation, genéralement parlant, à la condition de s’aligner sur les quatre autres critères.
Toutefois, ces autres modèles sont problématiques. Jusqu’à la dernière réfome de l’éducation au Chili, les écoles PPP (écoles subventionnées) pouvaient faire payer des frais supplémentaires, ce qui satisfaisait les stratifications socioeconomiques. De nombreux pays considèrent les PPPs comme étant un moyen à moindre de cout de satisfaire la demande grandissante en éducation, dans le contexte actuel de manque de financement pour satisfaire les SDGs. Bien que dans le meilleur des cas, les SDGs sont conçus pour offrir une éducation gratuite, les questions demeurent quant à leur effet d’égalité, mais aussi sur la localisation geographique de ces écoles ainsi que sur le poid financier pour les états à moyen et long termes. Egalement, vues les ressources limitées des états, les PPPs feraient faire une diversion à d’autres fonds, augmentant les risques de désinvestissement dans l’éducation publique, comme c’est le cas au Chili, Pakistan, Inde, Brésil et aux USA.
3. Est-ce que ces fournisseurs privés sont bien réglementés et suivis?
Une revue internationale des lois éducatives effectuée par RTE suggère autrement. Il y a des inquiétudes grandissantes sur la capacité des états (et surtout sur leur volonté) d’établir et d’effectuer le suivi de normes en éducation pour les fournisseurs privés (tels qu’en Uganda, Ghana, Kenya, ou Pakistan), particulièrement les pays à faibles revenus et ceux touchés par la corruption. Pareillement, il est bien connu que pour être rentable, les fournisseurs privés ont tendance à payer leurs enseignants des salaires plus bas, tels que dans les Concession Schools en Colombie ou écoles PPP au Pakistan, employant souvent des enseignants sous-diplomés. Les qualifications des enseignants et leurs statuts devraient être part entière des nomes minimales que les états mettraient en place. Les compagnies éducatives qui sont menées par des fins commerciales se mobilisent souvent contre le gouvernement pour qu’il ne règlemente pas le secteur et ne suive pas les normes existantes.
4. Est-ce que les PPPs discréditent la nature humaniste de l’éducation?
En raison de la logique du marché derrière la plupart des réformes de PPP, la rentabilité et la compétition prennent le dessus sur la priorité de rendre capable un enfant de développer son potentiel. Cela se termine souvent de la faàon suivante: les enseignants enseignent pour les examens, afin d’obtenir une bonne place dans les ligues scolaires. Cela peut aussi mener à des discriminations cachées (et parfois ouvertes), la séléction des élèves qui sont plus susceptibles de réussir, une sélection des enfants aux besoins particuliers ( tels que dans les écoles Concession Schools in Colombia, le Milwakee voucher program ou le Cleveland Scholarship and Tutoring Program aux USA).
En citant l’exemple du Chili, le Comité sur les droits de l’enfant a soulevé une inquiétude sur: ‘l’éducation étant strictement évaluée selon des normes instrumentales et cognitives et des indicateurs, excluant les valeurs et les attitudes telles que l’égalité des droits entre les hommes et le femmes, le développement de l’empathie, le respect des engagements, la participation démocratique et le respect de l’environnement”.
5. Est-ce que le rôle des acteurs du secteur privé est discuté publiquement en ligne avec les principes de transparence et de participation?
Dans le cas du Chili, cela n’était clairement pas le cas, étant donné que la réforme des coupons avait été éffectuée sous la dictature de Pinochet. Cependant, dictature ou non, la plupart des PPPs sont habituellement conçus et décidés à huis clos, sans consultation publique. De la même façon, ils sont très rarement le résultat d’une analyse consciencieuse de leur impact sur l’équité-particulièrement sur les groupes désavantagés. Ce débat, s’il y en a un, tourne généralement autour de leur potentiel à augmenter le choix, pour économiser de l’argent et pour augmenter la qualité de l’éducation par la compétition; en ignorant les risques contre les droits de l’homme mentionnés auparavant.

Dr. Maria Ron-Balsera est chercheuse et coordinatrice du plaidoyer pour le Projet Droit à l’éducation.
Nous remercions INEE pour la traduction de ce texte, également disponible sur le site.